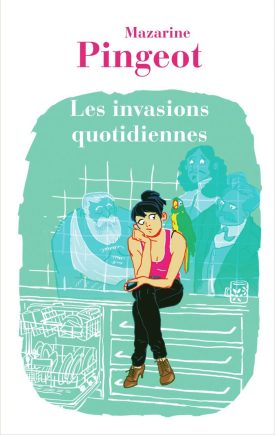Maylis de Kerangal
Que faire Nicolas ?
Enterrer les morts et réparer les vivants
— A. Tchékov, Platonov
Cela fait longtemps que je n’ai pas écrit d’article sur mes lectures, mais ce livre m’a bouleversée, émue aux larmes, remplie de réflexions, d’interrogations et de visions inattendues. Il a chamboulé mon quotidien, laissant derrière lui des mots que je n’oublierai jamais.
Je ne vais pas ici faire de résumé de l’histoire, il existe sur la page de l’éditeur – Éditions verticales – et sur toutes celles des catalogues qui le diffusent.

Durant toute la lecture du livre, nous suivons les organes, surtout le cœur, de Simon Limbres ; j’ai suivi, accompagné durant plusieurs soirées (le temps de la lecture du livre auquel j’ai accordé des pauses tant il est puissant, intense) la migration de ce cœur vers un autre endroit de la planète, vers une autre province, vers un autre corps, pour que ses battements continuent.
L’arrêt du cœur n’est plus le signe de la mort, c’est désormais l’abolition des fonctions cérébrales qui l’atteste. En d’autres termes : si je ne pense plus alors je ne suis plus. Déposition du cœur et sacre du cerveau – un coup d’État symbolique, une révolution.
L’histoire d’un cœur qui passe du corps d’un jeune homme de 19 ans à celui d’une femme mûre, pour la sauver, tandis que son premier hôte n’est déjà plus de ce monde. L’histoire d’un cœur, d’une promesse de vie, de ce lien si fragile qui nous relie et nous retient. La découverte des métiers de la médecine, concernés par la transplantation, qu’on ne connaît pas ou si peu tant qu’on n’est pas confronté au pire.
J’ai été émue et anéantie par la souffrance des parents du jeune homme, de ses proches.
Marianne entend cet homme qui l’appelle et elle pleure, traversée par l’émotion que l’on ressent parfois devant ce qui, dans le temps, a survécu d’indemne, et déclenche la douleur des impossibles retours en arrière…
J’ai été impressionnée par la maîtrise et l’empathie des infirmiers et des médecins. Révoltée par la brutalité de la mort.
Une heure plus tard, la mort se présente, la mort s’annonce, tache mouvante au pourtour irrégulier opacifiant une forme plus claire et plus vaste, la voilà, c’est elle.
Ils se regardent une fraction de seconde, puis un pas et ils s’étreignent, une étreinte d’une force dingue, comme s’ils s’écrasaient l’un dans l’autre, têtes compressées à se fendre le crâne, épaules concassées sous la masse des thorax, bras douloureux à force de serrer, ils s’amalgament dans les écharpes, les vestes et les manteaux, le genre d’étreinte que l’on se donne pour faire rocher contre le cyclone, pour faire pierre avant de sauter dans le vide, un truc de fin du monde en tout cas quand, dans le même temps, dans le même temps exactement, c’est aussi un geste qui les reconnecte l’un à l’autre – leurs lèvres se touchent –, souligne et abolit leur distance, et quand ils se désincarcèrent, quand ils se relâchent enfin, ahuris, exténués, ils sont comme des naufragés.
Des enfants de la fin des années soixante, ils vivent dans un coin du globe où l’espérance de vie, élevée, ne cesse de s’allonger encore, où la mort est soustraite aux regards, effacée des espaces quotidiens, évacuée à l’hôpital où elle est prise en charge par des professionnels. Ont-ils seulement déjà croisé un cadavre ? Veillé une grand-mère, ramassé un noyé, accompagné un ami en fin de vie ? Ont-ils vu un mort ailleurs que dans une série américaine Body of Proof, Les experts, Six Feet Under.
J’ai été secouée par l’immense douleur qu’elle provoque, épuisée par les longues nuits blanches dans les couloirs de l’hôpital aux côtés des infirmiers et des médecins pour veiller, consoler, écouter, soigner, réparer.
Il a annoncé la mort de leur fils à cet homme et cette femme, ne s’est pas raclé la gorge, n’a pas baissé la voix, a prononcé les mots, le mot « décédé », et plus encore le mot « mort », ces mots qui figent un état du corps.
Quiconque passerait la tête clignerait des yeux dans la lumière froide puis se formerait une image de champ de bataille après l’offensive, une image de guerre et de violence – Thomas frissonne, et se met au travail.
Thomas commence à chanter. Un chant ténu, à peine audible par celui ou celle qui se trouverait avec lui dans la pièce, mais un chant qui se synchronise aux actes qui composent la toilette mortuaire, un chant qui accompagne… Car ce corps que la vie a éclaté retrouve son unité sous la main qui le lave, dans le souffle de la voix qui chante ; ce corps qui a subi quelque chose hors du commun rallie maintenant la mort commune, la compagnie des hommes. Il devient un sujet de louanges, on l’embellit.
J’ai appris à mieux connaître le corps humain, ses organes, leur immense importance. Peu de livres savent me garder aussi longtemps. Celui-ci ne m’a plus quitté jusqu’au mot fin, impossible d’entamer une autre lecture à côté, même un essai. J’ai fait des escales, aux moments les plus difficiles, pour respirer, sentir mon cœur battre, appeler les miens, me rassurer de leur présence. J’ai fait des escales pour prolonger l’écho des mots, entendre ce qu’ils me racontaient par rapport à ma propre histoire, à celle aussi des hommes et des femmes qui m’entourent.
J’ai des questions, des questions sur le donneur, Harfang secoue la tête, l’air de penser qu’elle exagère, elle connaît la réponse. On en a déjà parlé. Mais Claire insiste, ses cheveux blonds forment des crochets contre ses joues, je voudrais pouvoir y penser. Elle ajoute, persuasive : par exemple, d’où vient-il ce cœur, qui n’est pas parisien ? Harfang la dévisage, fronce les sourcils, comment sait-elle déjà cela ? puis consent : Seine-Maritime. Claire ferme les yeux, accélère : male or female ? Harfang, du tac au tac, male ; il gagne la porte ouverte sur le couloir, elle l’entend qui s’absente, rouvre les paupières, attendez, son âge please. Mais Harfang a disparu.
Maylis de Kerangal est un grand auteur, un immense talent.
Elle possède cette manière de dire l’essentiel avec réalisme mais profondeur.